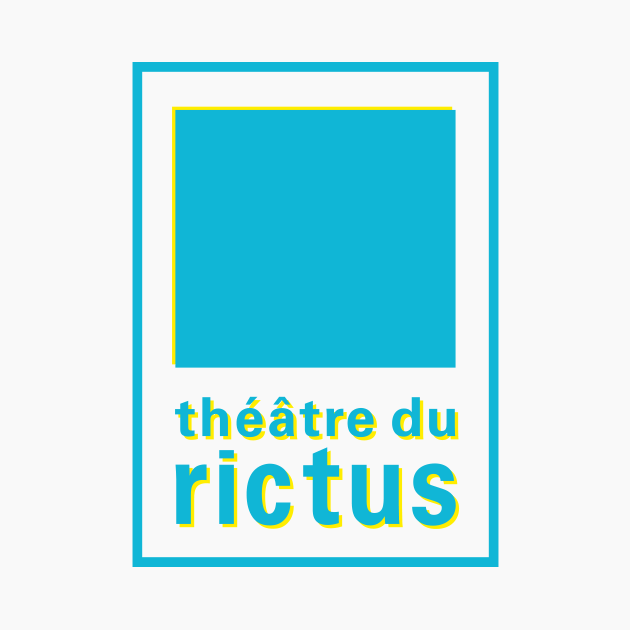Des nouvelles du front !

Un retour critique sur Fuck America par Isabelle Bonat-Luciani (son blog).
Une image d’illustration de Stéphane Pajot.
C’est toujours une expérience d’aller voir une pièce. Peut-être parce que je n’y vais pas souvent. Je suis allée voir Fuck America « à l’aveugle », sans rien savoir de l’histoire, ni de l’auteur que je ne connaissais pas. Fuck America est donc un roman de Edgar Hilsenrath. Pour moi c’était surtout une pièce de théatre de Laurent Maindon sans savoir qui était vraiment Laurent Maindon et le théatre du Rictus, excepté ces instantanés facebook qui tissent des échanges, des résonnances, des choses qu’on a envie de partager. L’occasion était belle. Je me suis assise très sagement dans ce théatre du Ring (je dis ça comme ça mais la programmation est franchement classe, je pense notamment à cette pièce vue au 104 par Jonas Hassen Khemiri, « Nous qui sommes cent » que j’étais heureuse de retrouver là, sur les murs d’Avignon).
J’avoue, les premières minutes j’ai eu peur. La raison est très bête : émotionnellement trop chargée par cette semaine d’épouvante, j’aurais voulu me plonger toute entière dans un univers ouaté, empli de bisounours volants et de bonbecs dégoulinants de rose (ça arrive parfois, c’est fugace et ça tient pas). Les premiers mots de la pièce étaient juif, Bronsky, consul général, ghetto. Bon. Raté pour Candy au pays de la licorne.
Bronsky a donc survécu aux ghettos nazis et débarque en Amérique, pays du rêve et de la liberté. On le voit dans le New York des années 50, clodo parmi les clodos à vivre de petits boulots, logé dans un bouge l’esprit pas tranquille qu’on vienne le déloger face aux impayés qui l’écrasent. Ecrivain la nuit et crève la faim le jour. Bronsky a le projet d’écrire un roman : « quelque part dans mes souvenirs, il y a comme un trou. Un grand trou noir. Et c’est par l’écriture que j’essaie de le combler ». Cette pièce nous donne à voir précisément cette affaire d’écriture, d’écrivain en devenir, elle se déroule sous nos yeux et certains mots restent, écrits en blanc sur l’écran tandis que la voix les porte. C’est très beau à voir, à lire, à garder ces phrases qui se notent sous nos yeux, comme un roman qui est en train de s’écrire dont on sent profondément la lisière à chaque fois entre l’humour et le drame. On suit ces petits boulots de merde, on rit sur ces limaces dans un restaurant aux codes de riches où les limaces s’appellent des escargots et que le comédien tente de découper avec couteau et fourchette puis finit par les bouffer avec leur coquille, les serveurs sont outrés mais bien dans leur rôles ils n’en montreront rien, tout est permis aux riches, même d’être cons. A Bronsky rien n’est permis dans cette amérique puisqu’il est l’intrus, le migrant et que cette condition de fait, l’exclue. Au mieux on l’ignore, au pire on le rejette. Les scènes s’enchainent à un rythme soutenu où l’on passe d’un univers à l’autre, de boulots au troquet où ses amis, les seuls qu’il peut avoir les mêmes que lui, à la pute qu’il aimerait bien baiser, aux lettres avion qui sont envoyées à personne et qui immanquablement reviennent, les gens sont-ils fous d’écrire des lettres aux membres de leur famille qui ont été gazés ? Qui est vraiment fou on se demande. Bransky ne lâche pas il écrit, il écrit son roman basé sur des faits réels, une histoire, son histoire. On le regarde trébucher, tomber parfois, crever de solitude et de désir. On voudrait lui tenir la main jusqu’au bout de la pièce. Peu à peu les mots lâchent « j’ai compris qu’il ne suffit pas de survivre. Survivre ce n’est pas assez ». Peu à peu, son obsession de liberté, de libération, fait renaitre le désir, sa virilité qui s’est retrouvée enterrée sur tant de cadavres.
On sort de là avec l’envie de tout lire Edgar Hilsenrath comme si soudain c’était fondamental, et je crois oui, que ça l’est. On garde les mots entendus avec l’envie d’y plonger tout entier, on garde la musique et les images qui permettent des dialogues entre l’écran et les comédiens sur scène. On y est, on voudrait bien y rester, on rit parce que c’est malicieux et on retient ses larmes quand même parce que ça parle, ça résonne, et questionne tellement aussi sur aujourd’hui. Fuck America de Laurent Maindon c’est cette pièce qui rend inévitable la rencontre avec Hilsenrath si elle n’a pas déjà été faite, pour les autres j’imagine, des retrouvailles que les comédiens viennent incarner avec justesse, sobriété et humanité.
 Théâtre du RICTUS
Théâtre du RICTUS